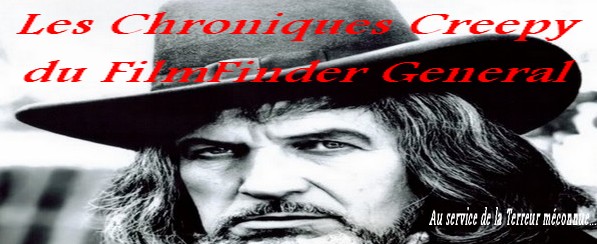En l'an de grâce 1990,
les hommes voyagent sans trop de problème dans l'espace (mwouhaha).
C'est alors que des extraterrestres entrent en contact, via radio
transmission, avec la Terre. Le message est clair : ils
arrivent. Mais alors que ces derniers sont en route pour enfin rendre
visite aux humains, leur vaisseau se crashe sur Mars. Aussitôt sur
Terre on s'organise pour leur porter secours. L'équipe de sauvetage,
une fois sur place, ne découvre qu'une seule survivante : une
alien ( certes à l'apparence humaine) mais à la peau verte. Et ils
vont s'empresser de l'embarquer à bord de leur vaisseau...
Bien que non crédité au
générique, le producteur et roi du bis Roger Corman participe
activement au projet Queen of Blood. C'est lui qui engage Curtis
Harrington comme réalisateur, après avoir été impressionné par
le travail de ce dernier sur le magnifique Night Tide. N'arrivant pas
à financer des projets plus personnels, Harrington accepte la
proposition de Corman qui consiste à tourner ( quasiment en même temps!) deux
films ayant pour tête d'affiche la star anglaise Basil Rathbone : Queen of blood et Voyage to the prehistoric planet.
Avec un budget riquiqui (
à la Corman quoi) mais un grand sens de la débrouille, Harrington
va réutiliser les scènes « à effets spéciaux » ( des
scènes de navigation spatiale quoi) de deux films de SF russes. Pour
le reste, des décors minimalistes feront bien l'affaire.
Décors en carton pâte,
accessoires en plastoc, FX cheapos, maquettes en guise de vaisseaux,
Queen of Blood est l'archétype même du film de SF pop ( fans
hardcore de hard sf, fuyez!) ambiance 60's. Et ça a un indéniable
charme. Surtout que la musique est au diapason (ho ho) avec des
passages au thérémine ! Et cette affiche, mon dieu, cette affiche ! Corman savait vendre du rêve !
Il faut également
souligner que Queen of Blood bénéficie d'un casting qui a de la
gueule. En tête d'affiche, nous retrouvons donc Basil Rathbone ( pour les
plus jeunes, signalons que Rathbone était une grande star du cinéma
britannique dans les années 30 et 40) c'est à dire Mister Sherlock
Holmes ( qu'il incarna 14 fois à l'écran!). Pas mal du tout, même
si la carrière de Basil Rathbone était en phase descendante en
1966 ( d'ailleurs il est décédé un an après.). Nul doute que Corman a dû finement négocier le cachet de la
star en déclin. En tout cas l'acteur anglais semble ici un minimum
prendre son rôle au sérieux ( même si apparemment il lui arrivait
d'oublier son texte!). Il incarne parfaitement un
scientifique enthousiaste, chef de mission qui va de l'avant. De
manière général, tous les acteurs ont l'air d'y croire. Le ton du
film est très premier degré. Et c'est magnifique !
Outre Basil Rathbone,
nous retrouvons John Saxon, dans le rôle du héros astronaute
américain, beau et intrépide. Un sacré baroudeur qui tourna des
films par palettes. Citons par exemple Opération Dragon ( avec Bruce
Lee), Black Christmas ( de Bob Clark) et bien entendu Nightmare on
Elm Street où il joue le rôle du père de Nancy. Bref, cet homme là
a tout fait dans le domaine de la série B et de la série TV :
du cinéma bis italien, de l'horreur, des films de kung-fu
etc..etc...Une légende quoi !
Un autre acteur perçait
petit à petit à cette époque : Dennis Hopper. Dans un
registre plus rêveur, plus fragile, que celui de John Saxon.
L'acteur s'était justement illustré dans Night Tide, et Curtis
Harrington a visiblement eu envie de retravailler avec lui. Pour
finir, n'oublions pas de citer l'actrice Florence Marly ( qui incarne
la reine Alien, et qui, comme son nom ne l'indique pas du tout est
d'origine tchèque). Corman la trouvait trop vieille et voulait donc
une actrice plus jeune ( une bimbo quoi!) mais Curtis Harrington a
insisté pour qu'elle aie le rôle. Et il a eu mille fois raison.
Avec l'aide d'un maquillage tout simple, Marly réussit vraiment à
être troublante. Son regard, son expression, sa gestuelle, laissent
vraiment transparaître le sentiment de convoitise gourmande qu'elle
éprouve à la vue des humains. On comprend tout de suite sa
dangerosité tout en ne niant pas le pouvoir de fascination du
personnage.
La patte Corman est aussi
évidente en terme de rythme et de durée du film. Ça
va droit au but, ça va vite. On est pas là pour jouer les
contemplatifs ! Le film, conscient de ses limites, a la sagesse
de ne pas trop durer ( 1h18, mes aïeux!). Usant de bonnes grosses
ellipses pour masquer ses limites budgétaires, Queen of Blood se
révèle un bon petit film de horreur/sf bourré de charme et
divertissant. D'ailleurs ce côté horreur/sf fera dire à Curtis
Harrington que Ridley Scott se serait bien inspiré de Queen of Blood
pour réaliser Alien. D'un autre côté, on peut dire que le
personnage que joue Florence Marly, avec son côté vampire végétal
et son mode de reproduction, est peut être inspiré de L'Invasion
des Profanateurs de Sépultures. J'y ai vu un lien. Mais c'est moi, hein ! En
tout cas Curtis Harrington fait partie de ces réalisateurs dont on
ne parle pas forcément beaucoup mais qui franchement avait un style,
un univers, très intéressants. Parmi ses films, outre Queen of
Blood bien sûr, il faut voir Night Tide, Games ( avec Simone
Signoret!) et Killing Kind notamment. Bref, un drôle de cas de
réalisateur. Mais un bon !